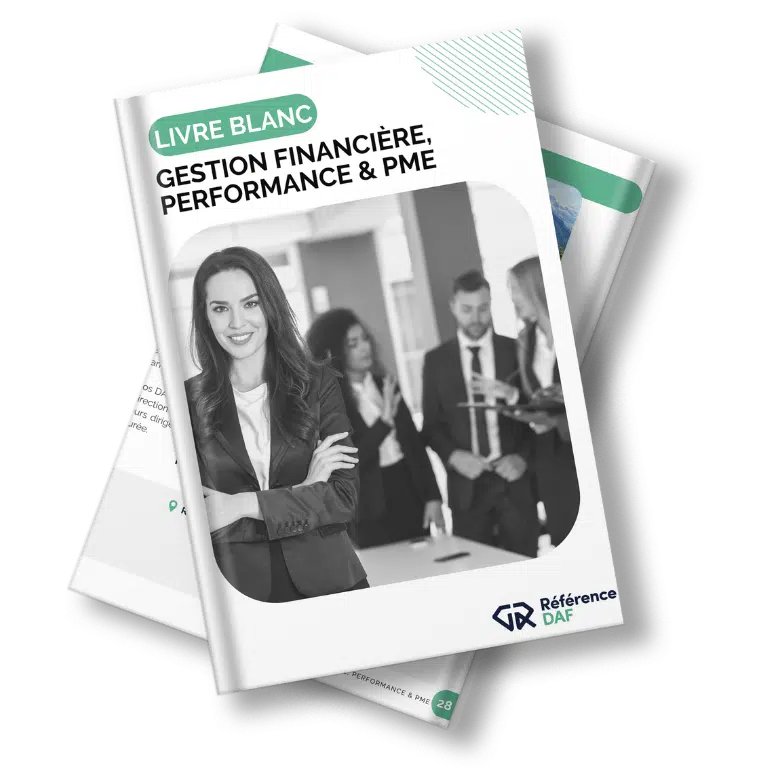La crise sanitaire qui dure désormais depuis mars 2020 a considérablement affecté les capacités financières des entreprises.
Le DAF, qu’il soit un daf externe ou salarié, se place au cœur de la gestion de cette crise, qui touche tous les aspects financiers de l’entreprise. Besoin de financement, gestion de la trésorerie et des stocks, hausse des prix et disponibilités des matières premières, les impacts sont nombreux.
Marie Boëdec-Menard, Directrice Générale de Référence DAF et Stéphane Pimienta, Directeur Général de LucaNet France, reviennent pour vous sur le rôle du DAF pour gérer les enjeux financiers de cette crise et préparer la suite.

Il y a d’abord eu une phase d’extrême urgence couplée à de fortes incertitudes (et donc des hypothèses floues). Le DAF a du rapidement, avec une mise en place brutale du travail à distance :
- faire face à de grandes inconnues sur le niveau d’activité
- modéliser, malgré tout, des impacts financiers de la crise sanitaire
- réaliser en urgence des demandes de financement (notamment les dossiers de prêts garantis par l’État) et d’aide (fonds de solidarité, chômage partiel).
Les aides ont été un outil indispensable à cette gestion de crise économique et financière. 75 % des sociétés ont fait appel aux aides mises en place par les pouvoirs publics. 70 % se sont tournées vers pour le chômage partiel, 53 % pour le report des échéances sociales, 41 % pour les prêts garantis par l’État.
Il y a ensuite eu une phase de confrontation avec la réalité, très mouvante au fil des différentes périodes d’alternance dites de «stop and go». Les DAF étaient sur le pont pour cette étape également. Il a fallu utiliser des portails complexes et lire entre les lignes de décrets qui changeaient régulièrement : évolution des mécanismes de calcul, des exonérations, des secteurs considérés comme essentiels ou non, etc.
Enfin, on est entré dans un stade de quasi-routine : les DAF savent désormais comment demander les aides, où et comment trouver les informations sur les évolutions constantes des règles.
Le DAF, un rôle clé dans cette gestion exceptionnelle
Ce contexte de visibilité de l’activité extrêmement réduite s’est traduit chez Référence DAF par la réalisation de réestimés quasi mensuels pour anticiper la gestion de trésorerie à 12/24 mois. Chaque confinement a par ailleurs engendré un repli, avec l’arrêt du recours à des prestataires de services par exemple. Il a donc fallu trouver des solutions innovantes comme financer le besoin en fonds de roulement avec un mécanisme de garantie inversée en cas de défaut de paiement du client au fournisseur.
Chez les clients de LucaNet France, là aussi le constat est que les DAF étaient sur le pont pendant ces 15 mois de crise, avec :
- la gestion du cash
- la «pêche» aux dispositifs d’aide des pouvoirs publics
- la refonte permanente des prévisions
- une gestion sociale (stress, risque de burn-out, etc.)
des réflexions sur l’avenir et d’éventuels plans de sauvegarde de l’emploi, etc.
Il a véritablement fallu faire un grand écart entre une gestion à court terme de l’urgence et à long terme de la stratégie. Il ne s’agissait pas seulement de demander des aides, mais aussi de les mériter, en fournissant des indicateurs de durabilité et de RSE qui se sont imposés comme des critères de financement.
Le DAF a donc été soumis à de fortes pressions, en passant d’une fonction support à un centre névralgique de l’entreprise, devenant la colonne vertébrale de sa pérennité à court, moyen et long terme. Par nécessité, le DAF gestionnaire est devenu un DAF stratège. Cela s’est accompagné d’une prise de conscience de l’importance de la digitalisation pour le transactionnel (factures, commandes) comme pour le décisionnel (budget, reporting).
Enfin, la crise a aussi été l’occasion pour la direction financière de rationaliser l’organisation et les outils. On a pu innover en interne, en mettant fin aux processus artisanaux ou remplaçant les solutions historiques par des solutions digitales, modernes, collaboratives et sécurisées.
Les enjeux financiers de la sortie de crise
On constate aujourd’hui une reprise forte de l’activité : le PIB est revenu à 97 % à son niveau d’avant 2020. On pourrait donc être optimiste sur la sortie de la crise, mais les aides de l’État ne masquent-elles pas une réaliste plus complexe? En effet, de nouveaux défis financiers apparaissent : les deux risques majeurs sont le mur de la dette et l’effet ciseau.
De nombreuses entreprises ont bénéficié des mesures d’urgence pour reporter leurs charges. Cela signifie que leur niveau va donc remonter à mesure que les aides vont se réduire. En parallèle, le coût des matières premières, soumises à une forte demande et à des pénuries, va augmenter, sans pouvoir nécessairement être répercuté sur les prix de vente. C’est ce qu’on appelle l’effet ciseau qui va affecter la génération de cash flow d’exploitation, particulièrement dans les secteurs industriels. On observe, par exemple, actuellement une hausse du coût de production de 4 % (jusqu’à 8 % dans le secteur automobile). Les industriels sont 27 % à se déclarer impactés par l’augmentation générale du prix des matières premières, contre 3 % habituellement.
Le BFR est très bas dans certains secteurs, mais va se reconstituer avec la reprise de l’activité et le durcissement des conditions de paiements. Parallèlement, la dette a augmenté, notamment par le report de charges (URSSAF ou bancaires) et le recours aux PGE. L’endettement des entreprises françaises a ainsi augmenté de 12,5 points en 2020. Le remboursement va se cumuler aux autres financements réalisés avant la crise. Pour les entreprises qui n’ont pas réussi à améliorer leur trésorerie, cela va donc être un risque. La modélisation de la génération de cash va devenir un point critique pour anticiper les marges de manœuvre ou les éventuelles difficultés.
Le Directeur Financier a donc besoin d’outils pour modéliser tous ces comportements. C’est le type d’outil que propose LucaNet France. Stéphane Pimienta en a réalisé une démonstration sur un cas pratique au cours d’un webinaire organisé par Référence DAF. Cet outil accompagne les directions financières pour modéliser les risques et se projeter dans un environnement, par définition, incertain.
Comment s’organiser dans un environnement durablement incertain pour le DAF ?
Cette crise va malheureusement se poursuivre et pourrait même être amenée à se reproduire. Le pilotage de la performance au niveau du compte de résultat et la génération de cash vont être des enjeux clés pour les directions financières. Pour cela il faut intégrer le plus facilement possible des changements d’hypothèses, conjoncturelles et/ou structurelles.
Il va donc falloir mettre en place des cycles de gestion, avec des budgets sur la base de scénarios, réestimés fréquemment pour s’adapter aux mieux aux circonstances mouvantes. Il s’agit d’identifier les leviers et les actions correctives à prendre en amont, avant la matérialisation des scénarios pessimistes. L’exercice budgétaire et d’autant plus les «rééstimés» récurrents sont souvent critiqués, car ils prennent du temps aux équipes. Toutefois, il faut impérativement voir ces exercices comme le moment de poser les hypothèses de l’activité pour déterminer les plans d’action.
Ces pratiques sont déjà ancrées dans les grands groupes, mais beaucoup moins dans les PME et les ETI. C’est parce qu’elles demandent une remontée d’informations et de KPI financiers de qualité avec de bons outils de simulation, faciles à utiliser. C’est un enjeu majeur et une révélation de la crise pour le Directeur Administratif et Financier. Il y a une nécessité de s’équiper pour permettre aux équipes des directions financières de passer plus de temps sur l’analyse et les projections que sur la production des indicateurs et des exercices.
Il y a malheureusement encore des freins de la part des dirigeants pour investir dans des outils dits «non productifs». Pourtant, un pilotage adéquat des pertes et profits ainsi que du cash flow permet de créer de la valeur à long terme et reste un objectif majeur pour le DAF dans un environnement durablement incertain.
Il faut se poser la question sur les plans des risques pris à ne pas mettre en place les bons outils de reportings financiers :
- manque de visibilité pour définir les actions correctives
- manque d’appréciation des risques
- faible circulation de l’information
- manque de collaboration
Le DAF, comme copilote du dirigeant, doit pouvoir préparer la sortie de crise grâce à l’investissement dans des outils d’automatisation des tâches à faible valeur ajoutée. Cela permettra à l’équipe de la direction financière de se dégager du temps pour l’analyse, la projection et le pilotage. Cela garantit également une culture de la gestion dans l’organisation pour mesurer les impacts des décisions prises et développer une logique d’amélioration continue, vitale dans un contexte aussi incertain.
Le Groupe Référence, créateur de Temps Partagé Augmenté®, est engagé dans la transformation digitale des PME. Les équipes du Groupe Référence proposent un accompagnement dans les fonctions de Direction Informatique, Marketing & Digitale, DRH et DAF.
Vous manquez d’expertise financière et souhaitez bénéficier d’un Directeur Administratif et Financier de 1 à 3 jours par semaine, selon vos besoins et dans la durée ?
Le Temps Partagé Augmenté est peut-être la solution à votre besoin ! Nos DAF à Temps Partagé Augmenté sécurisent et accélèrent au quotidien le pilotage financier des PME.Ils peuvent vous accompagner dans la structuration, le pilotage et les prévisions financières de votre activité.